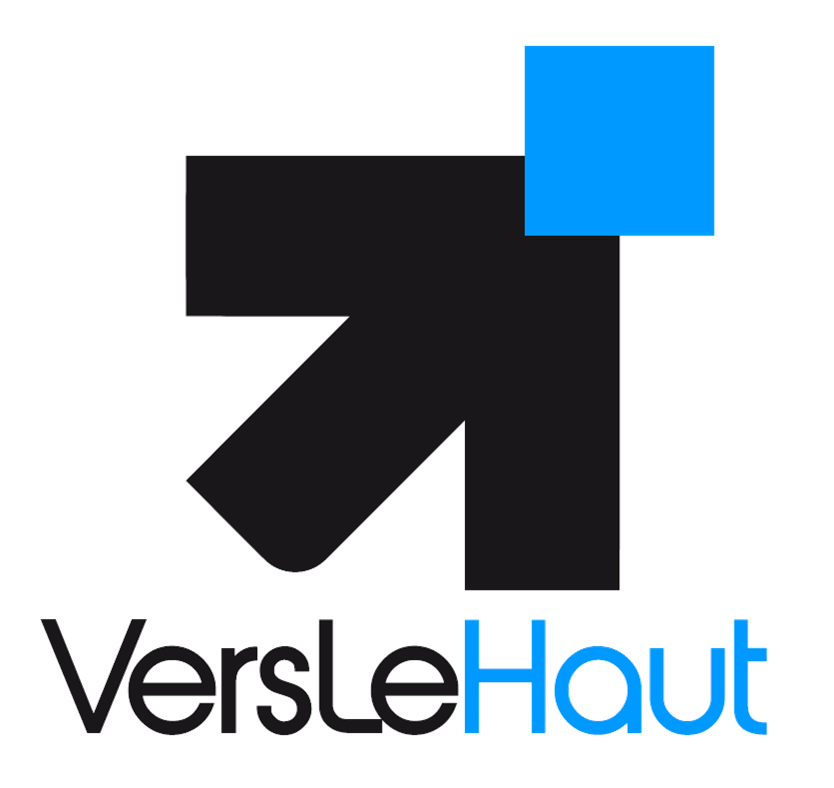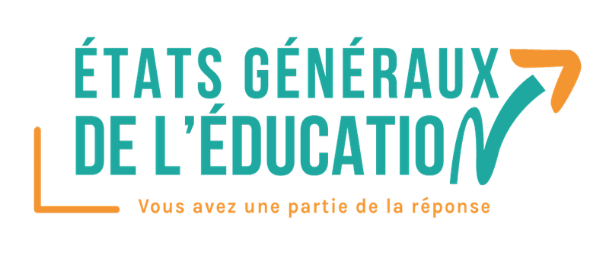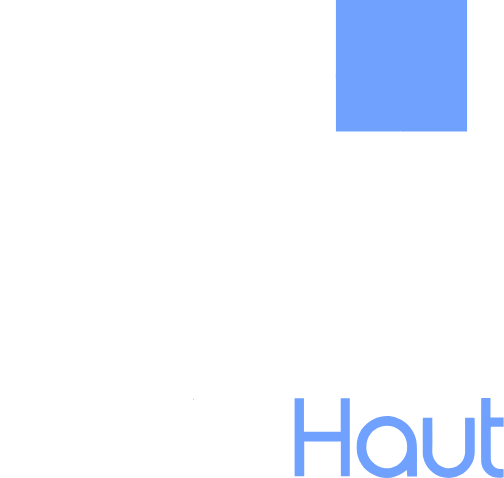Être parent n’est pas de tout repos. Surtout si on se réfère au flot d’injonctions, parfois contradictoires, auxquelles les expose le champ médiatique. Au point de faire peser sur eux une responsabilité trop lourde à porter ? Si les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, ils ne sont pas les seuls. Avons-nous suffisamment considéré notre responsabilité collective à les soutenir et les accompagner pour tenir le rôle que nous attendons d’eux ?
« J’en appelle à la responsabilité des parents. La République n’a pas vocation à se substituer à eux. » C’est par cette formule que le président de la République avait réagi à la participation de nombreux mineurs aux émeutes ayant fait suite à la mort de Nahel Merzouk, tué par balle par un policier à Nanterre le 27 juin 2023.
Ce faisant, Emmanuel Macron amplifiait une interrogation largement relayée dans les médias : « mais que font les parents ? ». Ce qu’ils peuvent bien souvent. 60% des mineurs interpellés lors des émeutes étaient élevés par un parent seul – la mère la plupart du temps.
Dans un article du Monde, le sociologue Pierre Périer notait que ces parents menaient souvent « des vies d’incertitude et de vulnérabilité permanente, qui ne les mettent pas dans une position forte pour asseoir leur autorité sur les enfants » et regrettait que la parole publique « fasse abstraction des conditions sociales d’existence et des difficultés multiples que les familles doivent surmonter »[1].
Comme souvent, ces évènements dramatiques ont tenu lieu de révélateur. Des difficultés des parents à exercer leurs missions éducatives mais également de notre propension à invoquer la responsabilité parentale plutôt qu’à prendre acte de nos manquements collectifs. La tentation de punir les parents d’enfants « délinquants » a même été envisagée par certains responsables politiques, avec le soutien de l’opinion.
Avant d’endosser cette conception punitive de la responsabilité, avons-nous suffisamment pris la mesure des difficultés exprimées par les familles ? Et des réponses que nous leur apportons collectivement ? Quelques éléments de réponse.
Des difficultés exprimées de longue date
Sans nier la défaillance ou le déni de certains parents, les difficultés que rencontrent une large frange des familles dans l’éducation de leurs enfants sont exprimées de longue date. C’est d’autant plus vrai sur la question de l’autorité vis-à-vis de leurs enfants.
En 2023, le Baromètre des Familles réalisé par OpinionWay pour l’Union Nationale des Associations Familiales (Unaf) nous révélait que 32% des parents interrogés estimaient qu’affirmer leur autorité est compliqué. Une enquête antérieure réalisée par la DREES identifiait un réel besoin de la part des parents dans ce domaine : 25% des parents en couple et 33% des parents isolés (familles monoparentales) souhaiteraient ou auraient souhaité recevoir de l’aide pour gérer l’autorité : mise à disposition d’information, groupes de parole, entretiens individuels avec des professionnels.
Un tiers des parents éprouvent des difficultés pour affirmer leur autorité
Au-delà de la question de l’autorité, les difficultés éducatives de parents concernent un large spectre : écrans, sommeil, alimentation, suivi scolaire, relations entre enfants. Une enquête menée par la Caisse nationale d’assurance famille (CNAF) en 2016 concluait que 43% des parents éprouvent des difficultés dans l’exercice de leur rôle[2] .Sur tous ces sujets, les parents sont largement exposés à des injonctions diverses et souvent contradictoires qui les laissent dans le flou.
Dans notre dernier baromètre Jeunesse&Confiance (OpinionWay pour VersLeHaut), 57% des parents disent être déstabilisés par les messages contradictoires, l’influence médiatique sur l’éducation des enfants (au moins de temps en temps). Par ailleurs, 51% d’entre eux disent rencontrer des difficultés à trouver des conseils auprès des professionnels de santé ou de structures spécialisées.
Quelle ambition pour le soutien à la parentalité ?
Cette prise de conscience avait poussé le gouvernement à mettre en place une commission scientifique « pour nos enfants et nos adolescents : soutenir la parentalité » – co-présidée par le psychiatre Serge Hefez et Hélène Roques, fondatrice de Notre avenir à tous – amenée à réfléchir sur les modalités de mise en œuvre d’une « politique plus affirmée d’accompagnement et de soutien des parents[3]».
Selon le rapport de la commission, on voit émerger de nouvelles façons de “faire famille”. Les familles sont moins nombreuses, l’âge moyen de la maternité a augmenté et les trajectoires se complexifient. En 2020, une famille sur 4 est monoparentale. Ces transformations rendent d’autant plus nécessaire une politique cohérente et structurée, afin d’accompagner les parents dans les défis qu’ils rencontrent au quotidien comme, instaurer un cadre, trouver un équilibre avec leur vie professionnelle ou s’adapter aux nouveaux usages des écrans. Concernant l’offre de soutien à la parentalité, la commission constate qu’aujourd’hui, elle est très variée. Les acteurs sont multiples – les caisses d’allocations familiales (CAF), les communes, les crèches, les établissements scolaires, le réseau associatif – et les dispositifs diversifiés. Ils peuvent prendre la forme d’ateliers, d’aides à domicile, de temps d’accueil parents-enfants ou encore de conférences. Néanmoins, les acteurs étant autonomes et leurs actions territorialisées, l’offre peut parfois se révéler peu lisible et morcelée. Ainsi, si la diversité des dispositifs permet de répondre à
une large gamme de besoins, elle souffre pourtant d’un manque de coordination et d’harmonisation à l’échelle nationale.
Pour répondre à ces enjeux, le rapport préconise de déployer une politique de soutien à la parentalité en tant que telle, afin d’adopter une approche préventive plutôt que curative. En intervenant en amont pour accompagner les familles de manière systématique tout au long des étapes clé du développement de l’enfant, certaines difficultés pourraient être évitées. Ces parcours d’accompagnement doivent se faire dans le cadre d’un véritable partenariat entre les familles et les institutions, les parents devenant acteurs et non plus seulement récipiendaires d’aides ou de dispositifs préétablis.
L’application de ces recommandations passent par une meilleure coopération entre les différentes organisations impliquées (état, CAF, collectivités territoriales, associations), par une accessibilité effective des dispositifs sur l’ensemble du territoire, mais également par une meilleure prise en compte de la diversité des schémas familiaux, en réfléchissant à des dispositifs spécifiques pour les parents les plus vulnérables.
Ainsi, par exemple, la commission propose de mettre en œuvre une offre socle de services de la parentalité, de densifier les lieux d’accueil enfants-parents dans toute la France, en permettant notamment aux associations d’obtenir des financements pluriannuels pour travailler dans la durée. Mais à quoi ressemble vraiment cette offre associative sur le terrain ?
Mais qui s’occupe des parents ?
L’offre d’accompagnement à destination des familles existe bel et bien mais est en effet parfois mal identifiée. Une enquête menée en 2016 par la CNAF concluait sur le manque de lisibilité pour les familles[4]. Cette confusion ressort également d’un récent sondage où 59 % des parents se disent mal informés sur les structures et les professionnels qui peuvent les aider et les accompagner en matière d’éducation[5].
Les centres de la Protection maternelle et infantile (PMI) proposent souvent des accompagnements. C’est le cas également des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP), des Lieux d’accueils enfant-parent (LAEP) et de quantités d’autres structures : Maisons des 1000 premiers jours, Maison des familles, mais aussi bibliothèques, ludothèques, centres d’animation de quartier.
59 % des parents se disent mal informés sur les structures et les professionnels qui peuvent les accompagner
Derrière toutes ces propositions, on retrouve aussi des intentions différentes, comme le souligne très justement le rapport de la fondation Break Poverty consacré à la petite enfance. Ce rapport distingue trois approches de l’offre associative adressée aux parents : le renforcement du pouvoir d’agir des parents, le renforcement du lien parent-enfant et l’outillage des parents par le biais d’interventions ciblées.
Les deux premières approches ont en commun une volonté de partir du parent, de ces besoins, de lui laisser l’initiative en proposant des ressources dont il décide de se saisir ou non. Ainsi, par exemple, le Réseau des parents, association active en Ile-de-France, propose à la fois des actions de soutien à la parentalité collectives (conférences, ateliers, groupe de parole…) et individuelles. Les sujets qui y sont abordés sont vastes et destinés à rencontrer la diversité des préoccupations des familles : périnatalité, place des pères, éveil des jeunes enfants, gestion des écrans, l’accompagnement de la scolarité, gestion des émotions et des relations.
Le modèle de la Maison des familles repose quant à lui sur un lieu d’accueil hospitalier pour les parents, avec ou sans leur enfant, dans le but de créer un espace de solidarité et de soutien d’abord entre familles. La priorité est la création d’un espace de convivialité, de construire des liens, plutôt que la réponse à un besoin spécifique formulé par le parent.
Parents : retour à l’école ?
L’approche visant à outiller les parents est toute autre. Elle cherche à diffuser des bonnes pratiques, souvent validées par des études expérimentales, dont la mise en œuvre est censée garantir un développement plus harmonieux des enfants.
Proposer des « pratiques » et « messages-clés », formulés par des acteurs spécialisés (hors du champ de la santé) est une approche très récente en France. Les familles ne se tournent pas forcément prioritairement vers des structures spécialisées. Comme le note Michel Vandenbroeck, docteur en sciences de l’éducation, en décryptant des études menées en France comme en Belgique, « en cas de difficultés, de questions ou de doutes, on s’adresse d’abord à son propre réseau familial ou social, ensuite à Internet, et ce n’est qu’en dernier ressort que l’expert entre en scène[6]. »
Dans les pays Anglo-saxons, les politiques de prévention sont beaucoup plus au fait de cette approche de la parentalité accompagnée, et plus « décomplexés », considérant qu’il n’est pas intrusif mais, au contraire, du devoir des spécialistes de partager des pratiques qui produisent des résultats probants sur la trajectoire des familles, pour lutter activement, par la connaissance, contre les inégalités.
L’effet avéré d’interventions auprès des parents pour les aider à construire et mener la relation à l’enfant a pu être mis en lumière par certaines recherches récentes. A titre d’exemple, aux Etats-Unis, des familles ayant été identifiées comme maltraitantes envers leurs enfants par le passé ont pu bénéficier d’une année de conseil thérapeutique portant sur la relation avec leur enfant. Le résultat a été spectaculaire. Chez les familles maltraitantes n’ayant pas bénéficié de cet accompagnement seulement 2 % des enfants ont été considérés comme bénéficiant d’un attachement sécure. Chez celles ayant été accompagnées, la proportion est montée à 61%[7]. En France, le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP) est un des rares programmes validés par la recherche ayant été déployé. Il s’agit d’un dispositif structuré visant à renforcer les compétences parentales et à améliorer la qualité des interactions entre parents et
enfants. Développé aux États-Unis et adapté en France sous l’égide de Santé publique France, il est aujourd’hui déployé dans plusieurs régions. Il repose sur un protocole précis, avec un nombre défini de 14 sessions de 2h et une progression établie, ce qui le distingue des autres formes d’accompagnement à la parentalité plus informelles ou ponctuelles.
Le programme se déroule sur plusieurs semaines et alterne des sessions distinctes pour les parents et les enfants, ainsi que des moments communs où ils expérimentent ensemble les apprentissages abordés. Les thématiques traitées incluent la gestion des émotions, la communication au sein de la famille, la mise en place d’un cadre éducatif structurant et le développement des compétences psychosociales. Les séances s’appuient sur des outils concrets et des mises en situation, avec une approche interactive permettant une appropriation progressive des pratiques proposées.
Le PSFP est mis en œuvre par des professionnels formés et s’appuie sur un réseau d’acteurs locaux (centres sociaux, structures périscolaires, collectivités) qui facilitent son déploiement auprès des familles. Le programme est actuellement déployé dans 11 régions françaises.
Une fragilité qui interroge notre ambition collective
Selon l’Union nationale des associations familiales (UNAF), les dispositifs de soutien à la parentalité ne touchent que 10 à 15% des familles aujourd’hui[8]. Le financement de ces initiatives est à ce jour très limité. Les dépenses de la branche famille consacrées au soutien à la parentalité restent par exemple très modestes par rapport à d’autres postes de dépenses (18€ en moyenne par famille sur l’année 2022)[9].
Les dispositifs de soutien à la parentalité ne touchent aujourd’hui que 10 à 15% des familles
D’autres facteurs contribuent également à fragiliser ce secteur. L’absence de labellisation ne permet pas toujours de distinguer les initiatives fiables de celles plus fantaisistes – même si certaines initiatives, comme la constitution des REAAP a pu viser à pallier ce problème d’identification.
Ces initiatives peuvent également être perçues parfois comme trop normatives, trop peu ancrées dans la réalité quotidienne des familles. Ces ambiguïtés ont marqué l’histoire récente des dispositifs de soutien à la parentalité et continuent de susciter des débats en France[10]. D’où la préoccupation croissante chez certains acteurs de ce secteur d’investir la dimension d’écoute, de non-jugement et d’articuler leur démarche autour du soutien entre pairs. Notre volonté d’agir collectivement pour soutenir les familles demeure manifeste au regard des moyens alloués – les dépenses en faveur des familles en France sont dans la moyenne européenne. Cependant, cet investissement important ne doit pas masquer le décalage qui peut se produire entre les besoins exprimés par les parents et les ressources qui sont mises à leur disposition. Encore trop souvent, les parents se sentent seuls face à leurs interrogations et se disent mal informés de l’offre qui leur est adressée.
C’est en faisant ressentir au quotidien aux parents qu’ils sont épaulés – par les autres éducateurs de leurs enfants, par leurs voisins, par des professionnels accessibles et bien identifiés – qu’on allégera le poids de la responsabilité qui pèse sur eux.
[10] Voir par exemple, Claude Martin (dir.), « Être un bon parent ». Une injonction contemporaine, Presses de l’EHESP, 2014.
[8] Union national des association familiales, 50 propositions pour donner confiance aux familles, 2022.
[9] Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2023.
[6] Michel Vandenbroeck, Être parent dans notre monde néolibéral, Editions érès, 2024.
[7] Cicchetti, Dante, Fred A. Rogosch, and Sheree L. Toth. “Fostering secure attachment in infants in maltreating families through preventive interventions.” Development and psychopathology 18.3 (2006): 623-649, cité par Tough, Paul. Helping children succeed: What works and why. Random House, 2016.
[4] Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins, op.cit.
[5] « Baromètre des violences éducatives ordinaires », étude IFOP pour la Fondation pour l’enfance, Octobre 2022.
[3] Lettre de mission adressée le 8 décembre 2023 par Aurore Bergé, alors ministre des solidarités et des familles, à Serge Hefez et Hélène Roques, co-présidents de la commission « Pour nos enfants et nos adolescents, être des parents. »
[2] Claude Martin (dir.), Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins, CNAF, La documentation française, 2017.
[1] « ‘Vous donnez une éducation à vos gosses, mais la rue prend le dessus’ : le désarroi des parents après les émeutes » publié le 13 décembre 2023.