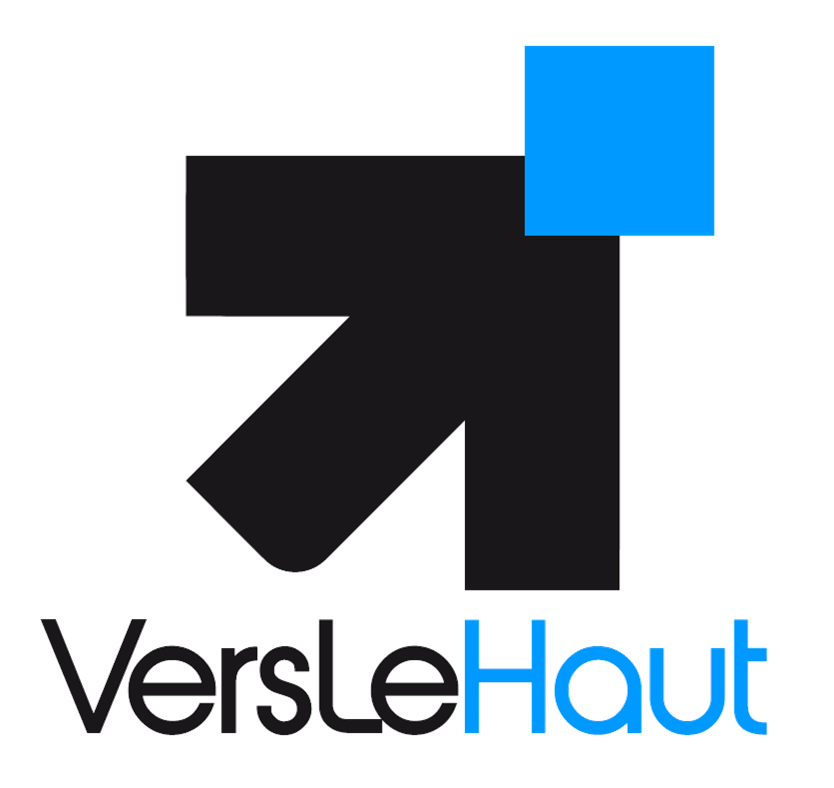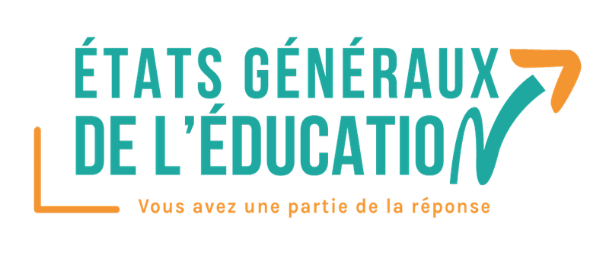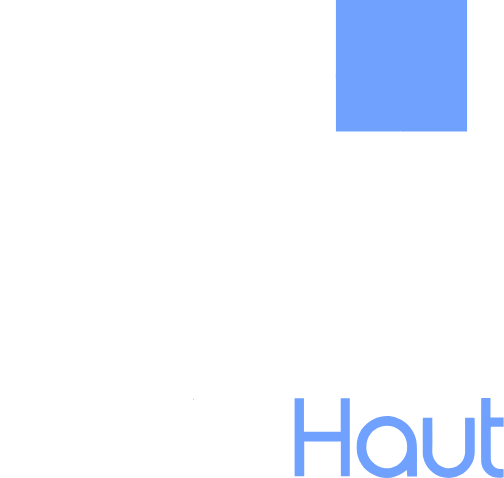Stéphanie Gruet-Masson
Après avoir appris que sa fille Alice était porteuse de troubles autistiques, cette ancienne avocate s’est engagée pour l’accompagnement des personnes neuro-atypiques.

Alice a quinze ans, elle est passionnée d’histoire et de médecine et vient de passer son brevet. En classe, depuis toujours, elle détonne : elle crie son ennui, éclate de rire quand un professeur s’énerve. Année après année, elle déroute ses camarades et interpelle ses professeurs. En choisissant d’accompagner sa fille, Stéphanie Gruet-Masson a changé de vie. Elle est devenue Job Coach auprès de personnes autistes et a créé un podcast « Tous pareils ou presque ».
VersLeHaut : Alice votre fille, a suivi toute sa scolarité à l’école, « en milieu ordinaire » et elle entre aujourd’hui en seconde. Peut-on dire qu’elle est représentative d’une génération « école inclusive » ?
Stéphanie Gruet-Masson : La loi de 2005[1] est évidement un progrès puisqu’elle ouvre l’école aux enfants en situation de handicap. J’ai pourtant été avocate, mais ce texte n’a pas eu d’impact dans le déroulé de la scolarité d’Alice, ni n’a représenté de recours particulier. L’école est mal en point, les choses ne vont pas en s’arrangeant, et les élèves comme Alice en cristallisent les difficultés.
Je pense que nous n’avons pas vraiment les moyens aujourd’hui de discuter de pédagogie ou de méthodes pour mieux prendre en compte le handicap en milieu ordinaire. En revanche, nous avons un peu de prise sur des petites choses du quotidien, à l’école et autour de l’école. C’est à ce niveau-là que j’aimerais aider les parents, les enseignants et les élèves, notamment par mon podcast.


« Tous pareils ou presque» est un podcast qui explore les multiples facettes de l’autisme et de la neurodiversité à travers les témoignages croisés des parents, des professionnels et des personnes autistes elles-mêmes. L’objectif est de permettre aux familles concernées, de faire un pas de côté et de retrouver inspiration et pouvoir d’agir. Il permettra aussi à tous ceux qui, sans être personnellement concernés, croisent parfois le chemin de ces personnes «extra-ordinaires» de mieux les comprendre, loin des idées reçues.
VLH : Les professeurs d’Alice ont-ils adapté leur enseignement à ses troubles autistiques ?
S. G.-M. : Je ne me suis pas confrontée à l’école comme un bloc institutionnel. J’ai rencontré différents éducateurs et chacun avait sa manière d’aborder l’autisme d’Alice. Certains enseignants n’ont rien mis en place de particulier, d’autres ont manifesté un engagement sans limites.
L’adaptation est de toute façon complexe, car l’autisme n’est pas intuitif. Le plus utile est de comprendre comment, en tant qu’autiste, on peut se sentir en surcharge sensorielle, avoir du mal à demander de l’aide ou à interpréter des situations sociales alors que d’un autre côté, on peut apprendre, comprendre et mémoriser sans problème des connaissances. Certains enseignants m’ont dit qu’ils considéraient ma fille exactement comme les autres élèves de la classe. Je comprends bien leur démarche, elle est pleine de bonne volonté, mais ce n’est malheureusement pas comme ça qu’ils peuvent l’aider, au contraire. Pour l’accompagner, il faut comprendre les 80% immergés de l’iceberg : ses particularités sensorielles, son mode de traitement des informations, son énorme fatigabilité…
Des associations existent pour faire entendre le témoignage d’un adulte autiste, et le seul fait de l’entendre peut complètement changer le paradigme dans la prise en compte d’un enfant souffrant de troubles autistiques. De manière générale, la coopération des enseignants avec des experts du médico-social quand elle est possible est un maillon essentiel.
J’essaie de rassurer les professeurs et de leur dire de ne pas chercher à situer Alice sur une grille de progression classique. Les progrès que l’on souhaite pour un enfant TSA sont plutôt de l’ordre de la création d’un lien social et émotionnel. Les compétences psychosociales se développent d’ailleurs et pourraient rendre visible ce type d’apprentissages.
VLH : Quel est le rôle des parents face aux équipes enseignantes qui ont en charge un enfant porteur de handicap ?
S. G.-M. : J’essaie de trouver ma juste place : à la rentrée, j’explique au professeur principal en quoi ma fille est particulière, je lui donne une fiche explicative avec quelques idées à mettre en place puis je me tiens à sa disposition, mais en retrait.
C’est délicat de la part des parents de donner des conseils aux enseignants. Les premiers sont dans la crainte et veulent protéger leurs enfants. Les seconds sont souvent débordés. Au final, les deux sont sur la défensive.
En revanche, si chacun sort de sa posture et se met à la place de l’autre, le dialogue peut s’ouvrir. Tout le monde est capable d’entendre la peur que ressent un parent pour son enfant, tout le monde peut comprendre les conditions difficiles dans lesquelles les enseignants exercent aujourd’hui. D’humain à humain, on peut mettre en place les bases de la coopération. On parle d’outillage et de formation, ce qui est évidemment important, mais on oublie la première étape : celle de se parler, et d’observer attentivement l’enfant. Et à défaut d’autre chose, c’est déjà énorme.
VLH : Sensibiliser les camarades de classe peut être à double tranchant : on risque de leurs faire perdre leur naturel face au handicap et en même temps, c’est nécessaire pour inclure l’enfant. Pensez-vous que la classe puisse être coopérative face au handicap ?
S. G.-M. : Là aussi, il y a des enfants qui se démarquent : des pépites, qui prennent ma fille en affection pour son originalité et sa franchise. Et les autres qui, pour la plupart, « font avec ». Ce que je cherche à éviter à tout prix, c’est le rejet, les moqueries, ou l’apitoiement.
De manière générale, je pense qu’il est toujours bénéfique d’expliquer les particularités de l’élève aux camarades. L’enfant porteur de handicap est le premier concerné, c’est à lui qu’il faut demander l’avis lorsque c’est possible. Il faut surtout le faire avec délicatesse et en étant conseillé, par le psychologue de l’enfant par exemple, pour ne pas risquer de commettre certaines maladresses qui ne sont pas sans conséquences pour l’enfant concerné.
Les adultes qui m’ont tendu la main alors que je me renfermais ont eu raison de le faire.
Une autre voie possible : s’adresser aux parents d’élèves. Avec l’autorisation des professeurs, je leur distribue une feuille en début d’année avec quelques mots sur Alice, pour les aider à répondre aux interrogations de leurs enfants face au handicap. Je ne leur dis pas en revanche quelle attitude pourraient adopter leurs enfants.
VLH : Est-ce que cela génère une forme de coopération entre parents ?
S. G.-M. : Certains parents sont venus me voir ensuite et m’ont exprimé leur soutien. On m’a demandé parfois si elle souhaitait être invitée aux anniversaires, on m’a proposé de l’aide. Je me souviens très précisément de chacun de ces gestes.
C’est inestimable. Les parents d’enfants handicapés sont nombreux à dire qu’ils souffrent d’isolement. Le vide peut se créer autour d’eux par pudeur ou parce que c’est effrayant, intimidant. Mais c’est aussi eux qui créent ce vide. Quand j’allais chercher Alice à l’école maternelle, tout était douloureux. Voir d’autres enfants montrer leur dessin à leurs parents était une souffrance. Alice n’avait pas ces réflexes simples, dont d’autres parents ne se rendent même pas compte. En conséquence, je suis devenue parfois ce parent pas très sociable qui ne reste pas à la sortie d’école. Les adultes qui m’ont tendu la main alors lorsqu’ils n’y étaient pas invités ont eu raison de le faire.
Les enseignants m’ont dit à quel point le handicap était porteur pour une classe et pour leur propre pédagogie
VLH : Considérez-vous que le fait qu’Alice puisse aller à l’école est une chance pour elle ?
S. G.-M. : C’est une chance que nous ayons eu les moyens de l’accompagner et d’y consacrer du temps et de l’énergie, tout en la maintenant dans le système public et l’école de quartier.
Mais l’école est une épreuve. Le brevet a généré énormément d’anxiété chez Alice. Elle est passionnée d’Histoire, mais elle n’a pas la capacité de concentration pour finir sa copie. On lui a demandé quelque chose qu’elle n’était pas en mesure de produire. Après cela, elle m’a confiée qu’elle se sentait capable de vivre son année de seconde mais qu’elle arrêterait ensuite : le bac lui paraît insurmontable.
Dans ces moments-là, on se demande si tout ça en vaut la peine. Nous tâchons d’affronter le présent, et de considérer chaque année scolaire sans trop penser à la suite – un exercice difficile car son handicap nous invite à anticiper le plus de scénarios possibles.
Et pourtant… L’école est probablement le meilleur endroit où elle puisse être : c’est là qu’elle sociabilise et que les autres enfants apprennent à côtoyer le handicap. Les enseignants , à plusieurs reprises, m’ont dit à quel point le handicap était porteur pour une classe et comment les adaptations pédagogiques pouvaient aider les autres élèves, voire les faire progresser eux-mêmes.
Chaque année, Alice progresse, imperceptiblement, sur des compétences sociales que je suis parfois la seule à percevoir. J’en informe les profs, qui me confient souvent leur sentiment de « ne servir à rien ». C’est faux : elle a osé demander de l’aide pendant le cours, c’est énorme pour un enfant TDAH ! Elle a eu une interaction de deux minutes avec un camarade, une victoire ! Ça ne se joue à rien, de petites interactions qu’il faut saisir au bon moment.
Propos recueillis par Camille De Foucauld, cheffe de projet
[1] La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées reconnaît à tous les enfants le droit à une scolarisation ordinaire, au plus près de leur domicile et à un parcours ordinaire.