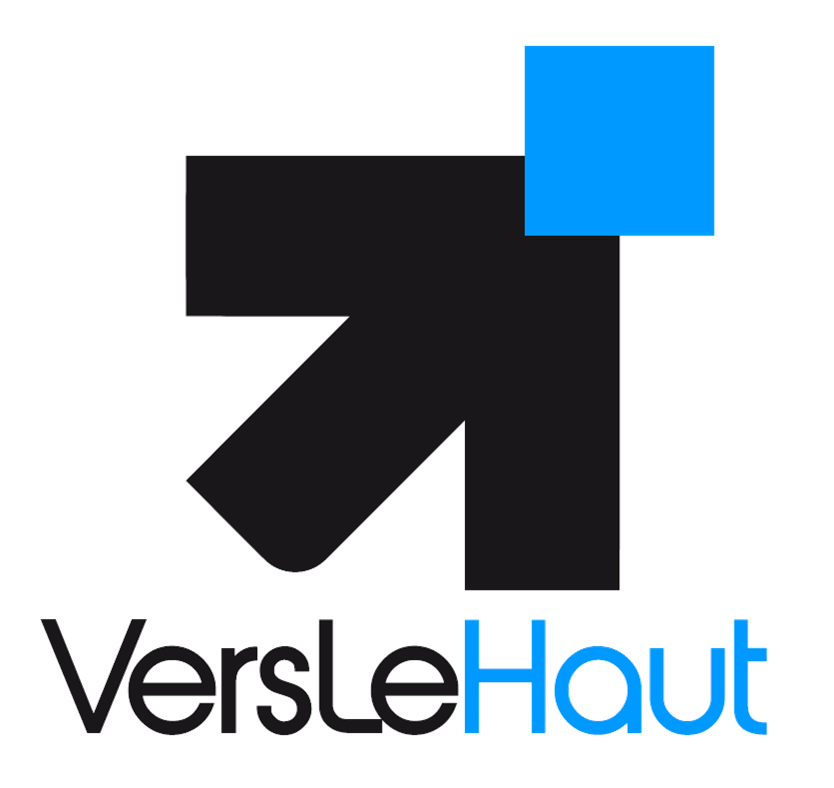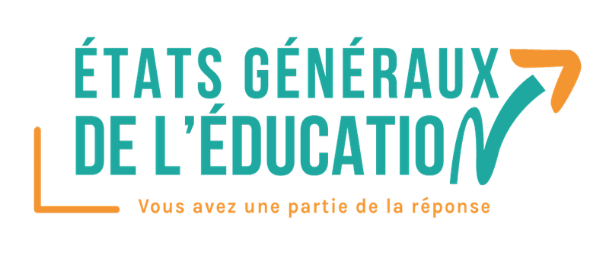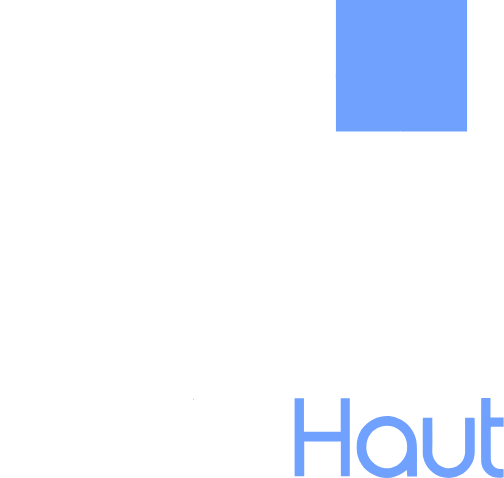Au moment de fermer le ban d’un été éclatant, on ne peut qu’être frappé par le contraste entre l’enthousiasme d’une Nation pour ses Jeux olympiques et le marasme des manœuvres politiques nées d’une majorité introuvable. La leçon estivale est claire : c’est le pouvoir qui va mal, pas la France.
Pour tous ceux qui retrouvent le chemin d’une école, d’un centre de loisirs ou d’un foyer d’accueil, le bien commun fait cependant bien pâle figure face aux éclatantes performances de nos athlètes. Que peuvent donc encore bien espérer les éducateurs de la politique ?
Une rentrée affranchie des injonctions politiques ?
D’abord un peu de calme probablement. Au terme de deux ans qui ont vu se succéder sans relâche quatre ministres, « école du futur », « pacte enseignant », « choc des savoirs » ou « écoles normales du 21ème siècle », la paralysie du pouvoir peut avoir quelque chose de rassurant.
L’attentisme de l’administration permet en effet de retrouver d’indispensables marges de manœuvre pour adapter les emplois du temps ou concevoir des projets pédagogiques. L’atonie du pouvoir invite à réinvestir le sens de son métier, à mieux soutenir ses élèves, à entrer en relation avec les familles. La paralysie politique offre une rare parenthèse pour enseigner sans s’attacher à une nouvelle polémique sur les groupes de niveaux, l’uniforme ou les méthodes d’apprentissage.
Au fond, le marasme du pouvoir permet de réaliser à quel point nous nous sommes accoutumés à priver les éducateurs de leur jugement, de leur liberté d’action, de l’indispensable part d’initiative de l’adulte face à un enfant. Parmi les pays de l’OCDE, nos enseignants sont ceux qui se disent le plus souvent stressés par l’obligation de suivre l’évolution des directives.
Retrouver le sens de l’action publique
Avons-nous à ce point perdu le sens de l’action publique que l’impuissance politique permette de renouer avec l’action, la coopération et la responsabilité ? La situation est aussi une invitation à reconsidérer ce que nous attendons de la politique.
Les dernières décennies ont montré que l’initiative politique n’apporte que confusion et désordre quand elle se substitue à l’action des personnes, quand elle prive les responsables de leurs prérogatives et de leur capacité d’initiative. En revanche, elle est indispensable pour fixer un cap, pour donner un cadre, pour assurer à chacun la sérénité du temps long, pour diffuser la confiance dans les institutions sans laquelle aucune initiative ne peut se déployer durablement.
C’est faute de cette exigence de subsidiarité que la politique perd prise avec le réel. Le spectacle de nos divisions doit guider une réflexion sur le juste niveau où les compromis pertinents sont le plus susceptibles d’émerger, où la décision est placée face à ses responsabilités, c’est-à-dire le plus près possible de ses effets concrets.
Pouvoir ou permettre ?
L’honneur de celui qui décide, c’est de se porter au service de ceux qu’il a l’immense responsabilité de diriger. Le politique répond aux besoins de l’administration, l’administration répond aux besoins des agents publics, les agents publics répondent aux besoins des citoyens. Pas l’inverse.
Au bilan, ce que l’éducation peut attendre du politique pour cette rentrée, c’est un peu de retenue.
Un véritable projet éducatif ne peut être qu’un projet de liberté. Il implique de permettre autant que de diriger, il doit créer les conditions d’une plus grande collaboration entre l’école et son environnement, entre l’Etat et les collectivités, entre le service public et la société civile. Il implique surtout de faire confiance : aux chefs d’établissement, aux enseignants, aux éducateurs, aux parents. Aux enfants surtout que la société n’a de cesse de rendre responsables de ses maux, des écrans au harcèlement.
En 2017, arrivant rue de Grenelle Jean-Michel Blanquer faisait le juste constat d’une perte de confiance et la promesse de ne pas ajouter une nouvelle loi au fardeau de l’école. Deux ans plus tard était publiée la loi pour « une école de la confiance ». Qui s’étonne encore de la défiance ?
Guillaume Prévost, délégué général de VersLeHaut