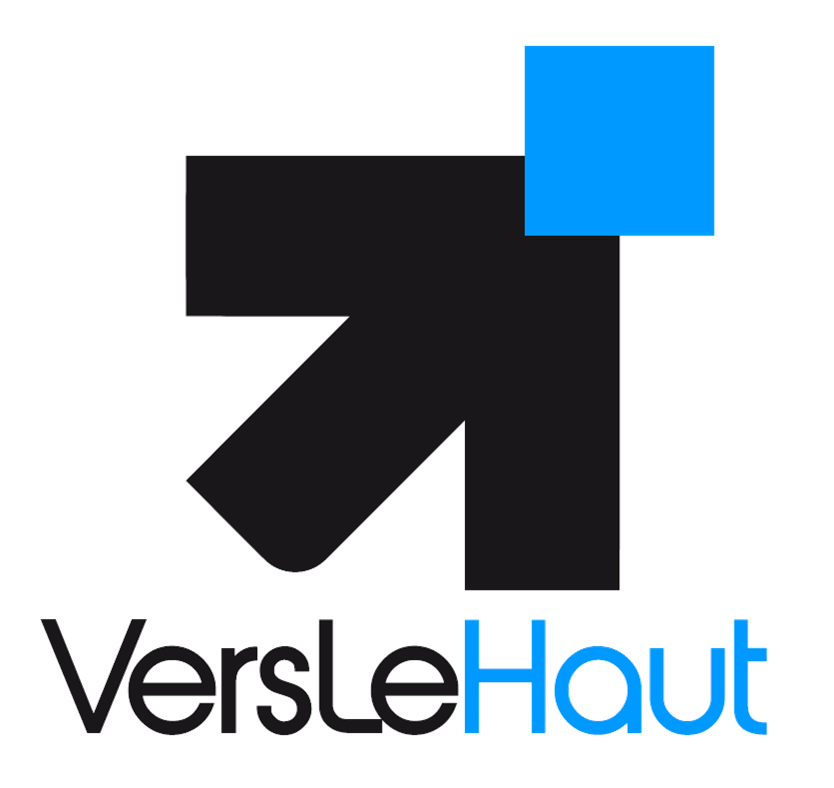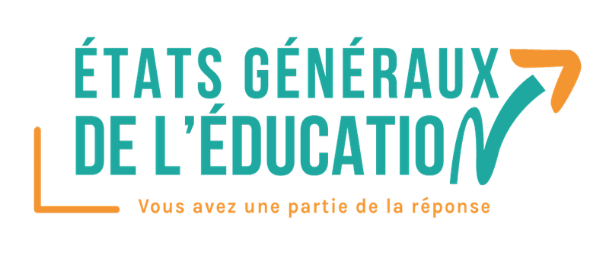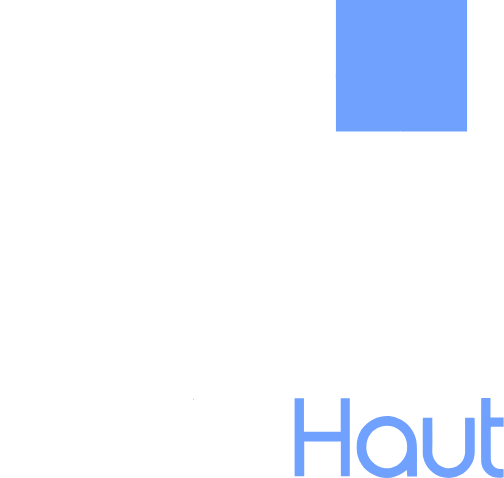Le vote contestataire est-il l’expression de la défiance à l’égard de l’école et du rejet d’une hiérarchie sociale fondée sur le diplôme ? Alors que s’avancent les élections législatives, une récente enquête auprès des électeurs d’extrême-droite éclaire les fractures de notre démocratie.
De 2016 à 2022, Félicien Faury, sociologue du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales au CNRS, est allé à la rencontre des électeurs du Rassemblement national[1]. Ses conclusions sont parfois discutables, notamment sur la place centrale qu’il accorde à un « racisme » dont les déterminants apparaissent au moins autant sociologiques qu’ethniques. Il n’en reste pas moins que ses travaux permettent de souligner la façon dont le diplôme en est venu à constituer une des fractures les plus profondes de la société française.
Société du diplôme
« Je ne suis pas fait pour l’école » : désabusée et vaguement coupable, la banalité de l’expression masque pourtant une objection concrète à l’ambition démocratique de l’école républicaine. Si on peut « ne pas être fait pour l’école », si d’emblée elle promeut certaines personnalités et repousse les autres, comment peut-elle prétendre élever ses élèves sans autre critères que « leurs vertus et leurs talents » comme le stipule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
À rebours des prétentions universelles de l’école, Félicien Faury montre que « pour beaucoup d’électeurs du RN, c’est le travail, plus que l’école, qui leur a permis d’accéder à un emploi stable et à un petit patrimoine ». Son enquête souligne l’opposition de deux types de légitimités sociales : d’un côté le labeur, la prise de responsabilité, l’expérience ; de l’autre, les études, le savoir, le diplôme.
En France, plus de la moitié d’une classe d’âge est désormais diplômée du supérieur, le quart à niveau Bac+5. Autrefois réservé à une minorité, le diplôme sépare désormais le pays en deux parties dont les opinions, les préoccupations et les aspirations apparaissent de plus en plus divergentes. Le baromètre annuel « Jeunesse&Confiance » de VersLeHaut montre que 77 % des bac+2 et plus sont optimistes pour leur avenir contre seulement 60 % des titulaires d’un CAP. Plus avant, l’accès aux ressources essentielles pour construire son avenir – santé, activités sportives, culture – apparaît largement lié aux études supérieures.
Au bilan, les indicateurs de suivi des objectifs éducatifs de l’Union européenne pour 2030 dessinent une société du diplôme : les jeunes Français sont désormais scolarisés pendant plus de 18 ans, de 3 à 21 ans en moyenne, et leur niveau réel continue pourtant de s’affaisser, en compréhension de l’écrit comme en culture scientifique (figure 1).

Figure 1 – Situation de la France par rapport aux objectifs éducatifs de l’UE pour 2030 (DEPP, 2023)
Inquiétudes vis-à-vis de l’école
L’enquête de Félicien Faury souligne l’inquiétude des familles populaires vis-à-vis de cette compétition scolaire : « contrairement aux groupes mieux pourvus en ressources culturelles, il est plus difficile pour eux de mettre en place des stratégies de compensation ». La démocratisation des études secondaires renforce paradoxalement le poids du capital culturel, magistralement dépeint par l’ouvrage collectif Enfances de classe (Seuil, 2019), dirigé par Bernard Lahire, ou par les stratégies parentales d’évitement scolaire mises en évidence par les travaux d’Agnès van Zanten.
Cette inquiétude renforce l’attrait des écoles privées, notamment à l’entrée au collège : entre le CM2 et la 6ème, la part des enfants scolarisés dans le privé passe de 17 à 24 %[2]. Davantage qu’une supposée excellence académique, le privé offre un environnement perçu comme plus protecteur : « le choix du privé est conçu, au fond, comme anormal, et les élites dirigeantes en sont en grande partie tenues responsables ». Cette éviction constitue, d’après Faury, une des causes déterminantes du vote des femmes pour le RN, notamment des mères.
Le propos est d’autant plus saisissant que la défiance à l’égard de l’école constitue également une dimension forte des émeutes de juillet 2023, largement occultée par l’opposition avec les forces de l’ordre. Près de 250 écoles ont été prises pour cibles, autant que de commissariats. Le profil des jeunes interpellés souligne également leur déshérence à l’écart des dispositifs publics d’éducation ou d’insertion : 40 % sans emploi, 67 % sans baccalauréat. A contrario, les diplômés du supérieur ne représentent que 5% des concernés[3].
Comme le dit le sociologue François Dubet, « sélection scolaire et sélection sociale ont fini par faire cause commune ». L’école faisait figure d’ascenseur social quand elle n’accueillait qu’une minorité d’écoliers au-delà des études primaires, quand la sélection sociale se jouait dans l’entreprise, dans les communautés rurales. Progressivement chargée de l’instruction de toute une génération, l’école est devenue de facto l’opérateur d’une sélection sociale perçue comme d’autant plus inique qu’elle contredit la promesse d’une réussite par le mérite (figure 2).
Faute d’avoir su relever le défi de la démocratisation, l’école est devenue un douloureux symbole de relégation pour les familles populaires. Un chiffre permet de mesurer le lien entre l’échec scolaire et la question sociale : dans les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), qui regroupent les collégiens en grandes difficultés scolaires, quatre enfants sur cinq sont issus de familles populaires. A rebours des oppositions politiques, le vote RN et les émeutes urbaines sont-ils deux faces d’une même exclusion ?

Figure 2 – Niveau des élèves de quatrième en fonction de l’indice de position sociale (IPS) du collège (DEPP, 2023)
Rejet des élites culturelles
Enfin, le travail de Faury souligne la défiance à l’égard d’élites dont le capital symbolique garantit la position sociale. L’auteur pointe en particulier le rejet des « professions spécialisées dans l’usage du savoir, de la parole et des symboles qui suscitent scepticisme et hostilité ». Ces « élites du diplôme », enseignants, journalistes, artistes, sont associés à une position de privilégié moralisateur, des « beaux parleurs » et de « donneurs de leçons ». De ce point de vue, « le mépris de classe dont s’estiment parfois victimes les électeurs du RN fait écho aux formes de violence symbolique dont l’école est un des principaux foyers ». Au bilan, l’enquête montre que le débat public manque, en partie au moins, les ressorts du vote contestataire. Comme l’a montré le sociologue américain Christopher Lasch[4], la société du diplôme fragilise le sentiment d’égalité démocratique en distinguant les citoyens sans véritable lien avec l’utilité commune. Alors que les entreprises peinent à recruter, le lien entre études et création de richesse apparaît en effet de plus en plus ténu : dans la France de « la réussite pour tous », le taux d’emploi des jeunes reste inférieur de plus de 7 points à la moyenne de l’OCDE.
Les difficultés existentielles des jeunes, qui étudient désormais jusqu’à 21 ans en moyenne, relativisent l’importance de la course au diplôme. Les succès du Service civique et de l’alternance montrent l’intérêt de nouveaux modèles éducatifs, davantage fondés sur l’expérience, la prise de responsabilités et l’insertion dans des collectifs. Dans une société en plein bouleversement, les mutations de l’éducation ne font probablement que commencer.
[4] La Révolte des élites et la trahison de la démocratie, 1995
[3] « Repères et références statistiques 2022 », Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, ministère de l’Education nationale (2022)
[2] Analyse des profils et motivations des délinquants interpellés à l’occasion de l’épisode de violences urbaines de juillet 2023, Mission conjointe des inspections générales de l’administration et de la justice, (2023)
[1] https://theconversation.com/la-defiance-envers-lecole-facteur-cle-du-vote-rn-231458?utm_source=twitter&utm_medium=bylinetwitterbutton